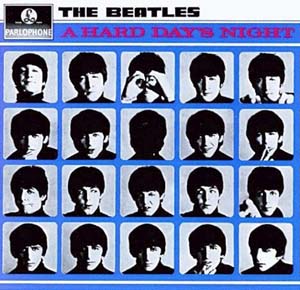Je reproduis ci-dessous un entretien publié sur le site du webzine Il était une fois le cinéma. Il s'agissait d'évoquer les relations entre le rock et le cinéma. Si vous préférez lire l'article sur leur (excellent) site, où l'on trouve par ailleurs nombre d'articles, d'entretiens, de chroniques et même des extraits de la revue papier “Jeune Cinéma”, c'est Ici
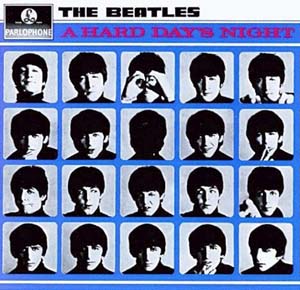
Sur les rapports entre Rock et Cinéma : entretien avec François Ribac, compositeur de théâtre musical et sociologue
Article de Marie Corberand et Olivia Dallemagne
"On ne peut pas schématiser “le rock", sous peine de le réduire. Il faut le comprendre, l'aborder dans sa diversité, comme une galaxie de styles qui compte des généalogies, des ancêtres, des révoltes, des alternatives : un monde en mouvement."
Quelle a été votre première expérience de rock au cinéma ? J'avais douze ans et la mère de mon meilleur ami nous a emmenés un mercredi au cinéma place Gambetta (à Paris) voir
Quatre garçons dans le vent –
A Hard Day’s Night, le premier film des Beatles. Quelques jours après, j’ai acheté une petite guitare électrique en plastique aux Magasins Réunis (Place de la République). Puis, j'ai proposé à deux amis de faire une imitation (en playback) des Beatles, chacun incarnant un des membres du groupe (sauf Ringo que personne ne voulait jouer)... J’avais déjà entendu les Beatles, ma mère possédait l'album
Abbey Road qui était leur dernier disque enregistré (1969), mais ma vocation musicale date vraiment de ce film.
Quels seraient, pour vous, les différents styles de films rock ? Dans une discussion antérieure avec Thierry Jousse (publiée dans les revues
Mouvements et
Volume), nous avions réfléchi à une sorte de typologie :
1- Il y a tout d’abord les films tournés au moment où les artistes ou les formations sont en activité, ce que j'appellerais le
"rock en action”. Il s'agit principalement de documentaires (ou de films se présentant comme tels) consacrés à des festivals, des tournées ou des concerts, comme précisément
A Hard Day's Night (1964). Ce genre particulièrement foisonnant a été détourné par Rob Reiner dans
This Is Spinal Tap (1984). Présenté comme un vrai documentaire sur un groupe, le film narre avec férocité les conflits internes au sein du groupe, les changements de style au gré des modes, les tournées harassantes et dresse un portrait très dur des acteurs de l'industrie musicale (managers, attachés de presse, patrons de majors, artistes, entourage…).
This Is Spinal Tap est devenu tellement emblématique dans le monde anglo-américain que les acteurs du film ont d’ailleurs fini par créer un vrai groupe de rock et faire des disques et des concerts. Il y a là un effet de réalité que je trouve fascinant.
2- Viennent ensuite les films de fiction dont les
protagonistes sont des musicien-ne-s de rock. On pense aux nombreux rôles interprétés par Presley à Hollywood (
Jailhouse rock de Richard Thorpe -1957- étant sûrement le plus réussi), aux films
Help de Richard Lester (1965) et au dessin animé
Yellow Submarine de George Duning (1968), avec les Beatles. On pense aussi aux
Monkees, quatre jeunes acteurs (dont deux étaient des musiciens confirmés) qui jouaient le rôle d'un groupe de pop dans une série de télévision américaine des années soixante. Dans ces “films prétextes”, la narration a pour objectif d'introduire des situations où les artistes peuvent chanter, une contrainte qui rappelle évidemment les comédies musicales où l'on bascule sans cesse de la convention théâtrale à celle du music hall.
À cette “catégorie” pourraient s'ajouter les productions où des stars du rock, par exemple Marianne Faithfull, Mick Jagger, David Bowie, Madonna, Eminem deviennent des acteurs dans des films pas forcément musicaux. On est là en présence du moment où les stars du rock deviennent (ou tentent de devenir) des stars du cinéma.
3- Il y a également les films qui s'
inspirent de la vie d'artistes rock, de disques, de styles musicaux ou de l'industrie musicale. Je pense notamment à des films comme
Tommy (1975), l'opéra rock des Who transposé à l'écran par Ken Russel, au chef-d'œuvre de Brian De Palma
Phantom of the paradise (1973), et bien sûr aux biopics. Pour illustrer ce domaine, en plein essor, on peut citer
Walk the line (de James Mangold - 2005), à propos de Johnny Cash, ou
Control (de Anton Corbijn -2007), qui propose une interprétation - à mon avis problématique - du suicide de Ian Curtis (chanteur de Joy Division). Cette approche rétrospective a aussi son pendant documentaire ; citons l'enquête sur Kurt Cobain de AJ Schnack (
About a Son - 2008), ou ethnographique (
Mississippi Blues de Bertrand Tavernier et Robert Parrish - 1983) et, plus près de nous, la série de films sur le blues produit par Scorsese. Dans un registre, à mi-chemin entre fiction et documentaire, on doit aussi mentionner
The Osbournes, le reality-show consacré à la famille de la star du rock
Ozzy Osbourne. Ce qui est intéressant dans ce registre, c'est que le rock devient la matière même de la fiction, sa matrice.
4- La quatrième catégorie - cousine de la précédente - consiste dans des films qui n’utilisent pas forcément de musique rock mais qui lui empruntent son
“esprit”, ses figures, ses personnages. Prenons par exemple
l’Equipée sauvage de László Benedek, avec Marlon Brando (1953). Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film mais Brando et sa bande de blousons noirs à moto incarnent d’une certaine façon les jeunes qui écoutaient du rock’n’roll ou tout du moins de la “musique de jeunes” dans les fifties. On peut aussi trouver cette trace du rock dans les films de David Lynch (qui recourt par ailleurs beaucoup à cette musique comme une sorte d'acteur à part entière de son vocabulaire), etc...
5– Cinquième catégorie, les films qui utilisent le rock comme
bande son. Les archétypes de ce genre sont probablement
Blackboard Jungle de Richard Brooks (1955) avec “Rock around the clock" de Bill Haley, ou encore
Easy Rider de Dennis Hopper (1969), véritable catalogue du son psychédélique américain des sixties.
Cet usage du rock s'est d'autant plus répandu avec le temps que, d'une part, les éditeurs et/ou les firmes de disques se sont rendu compte qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent en plaçant des chansons dans des films et, d'autre part, parce qu'à l'image de leur public, nombre de réalisateurs ont grandi avec le rock.
Avec cette relation, on comprend un peu plus ce que le rock et le cinéma s'apportent mutuellement : nombre de chansons trouvent une audience grâce au cinéma, tandis que certaines songs deviennent les marqueurs indélébiles de certains films. Ainsi, pour beaucoup de gens, la version de Harry Nilsson de “Everybody’s talking” (composée par Fred Neil) évoque immédiatement
Macadam Cowboy de John Schlesinger (1969), et la figure de Dustin Hoffmann.
Bien sûr, au fur et à mesure que le temps passe et que les supports sur lesquels se posent les images (clips, télévision, jeux vidéo, web) et les styles musicaux se diversifient, toutes ces “catégories” se démultiplient et s'hybrident.
Concernant les fictions inspirées par le rock, les biopics, quel regard portez-vous sur les films récents (Walk the line, Control, ou I'm not there sur Bob Dylan) ?Ce développement des biopics rejoint un peu ce que le sociologue anglais Simon Frith dit depuis environ quinze-vingt ans et que j'ai mentionné à l'instant : le rock n’est plus uniquement une musique de jeunes. Du côté du public comme de celui des cinéastes, des générations ont été formées par le rock et s'intéressent à son histoire. De ce fait, les biopics réfléchissent (dans tous les sens du terme) à la musique qui a construit ceux et celles qui l'aimaient. D'autant qu'à travers le portrait d'artistes, nombre de cinéastes esquissent les contours d'une époque, non pas, comme on l'entend souvent, parce que la musique reflète la société, mais plutôt parce que la musique est un des moments de la société, une pratique au sein de laquelle se manifestent et se re-construisent les rapports sociaux. Or, ces relations entre les personnes sont le sujet même du cinéma.
Il me semble que c'est un peu de cette façon que Todd Haynes évoque l'Amérique avec
I'm not there. Les différentes facettes stylistiques et personnelles du poète/chanteur Dylan lui permettent de mettre en scène successivement le far west, le statut des noirs américains, la dépression, les poètes beatniks, la campagne, la ville etc... Comme
Greil Marcus l'a fait dans certains de ses livres, Haynes fait de Dylan un médium justement parce que, comme je le disais plus haut, Dylan est bien un moment de l'Amérique, de son histoire, des controverses qui s'y sont déroulées.
J'observe également que de récentes fictions consacrées à des styles ou des artistes, comme
24 Hour Party People (de Winterbottom - 2002) ou
Ray (de Taylor Hackford - 2004), résultent d'un travail minutieux de documentation et d'interviews. Dans ces films, les acteurs principaux se réincarnent littéralement dans la peau de leurs modèles Ian Curtis ou Ray Charles. Il me semble qu'il y a vingt-cinq ans, le travail de reconstitution n’était pas aussi central.
The rose (de Mark Rydell -1979) est ainsi inspiré directement de la vie de Janis Joplin, mais sans qu’aucune chanson de la chanteuse (en tout cas pas à ma connaissance) ne soit présente dans la bande son, et avec une actrice principale (Bette Midler) qui ne cherchait pas à s'inspirer directement de Joplin.
Certains réalisateurs privilégient le style documentaire pour traiter des icônes du rock (Jim Jarmush sur Neil Young dans Year of the Horse (1997), Martin Scorsese sur les Stones (Shine a light - 2008) : quelle est, selon vous, la spécificité du documentaire ?
Bien entendu, il est impossible de résumer le style et les parti-pris des documentaires rock, il y en a trop (que je n'ai pas vus !), et depuis longtemps maintenant. Cependant, pour beaucoup de cinéastes, l'événement central du rock, c’est le concert et ce qui va avec ; la vie des musiciens, leur rapport avec les fans et tout l'environnement technique et humain des tournées. Le cinéma rock compte de grands films de cet acabit, comme par exemple le génial film de Pennebaker sur le dernier concert de Bowie en tant que
Ziggy Stardust (1973), ou encore
Monterey Pop (là encore de Pennebaker -1968), ou
Woodstock (de Michael Wadleigh -1969). Notons au passage que ces films ne sont pas de “simples captations” (ce qui de toute façon est illusoire au cinéma). Bien au contraire ! Pour restituer des performances scéniques, on filme sous tous les angles, on met côte à côte plusieurs écrans dans
Woodstock (à la façon du
Napoléon d'Abel Gance -1927), on fait se succéder des fragments de chansons et différents artistes (tout du moins ceux qui consentent à être filmés), on filme les coulisses, on recourt sans arrêt au montage... En d'autres termes, on fait du cinéma. Pour l’anecdote, pour
The Last Waltz (1978), film où le groupe The Band invite d'autres artistes à son dernier concert (Dylan, Clapton, Joni Mitchell etc..), Scorsese n'hésite pas à retourner des plans après le concert et à les insérer au montage. Au sujet de Scorsese et du rock, il faut d'ailleurs rappeler qu'il a travaillé au montage de
Woodstock, et que plus généralement son rapport au rock mériterait une étude.
Et puisque l'on en est à parler de la façon de filmer le rock en “live", je crois qu'il faut mentionner deux points, d'ailleurs liés, que l'on retrouve tant dans les documentaires que les fictions.
- Tout d'abord, c'est le fait de filmer le public. Ailleurs, on le fait peu. Dans les films d’opéra par exemple, on ne filme pratiquement pas le public ; Bergman dans
La Flûte enchantée (1975), ne filme le public qu’au début, pendant l’ouverture, au moment justement où il ne se passe rien sur la scène. C'est encore plus patent dans le
Don Giovanni de Losey (1979), où la transposition de l'opéra de Mozart en fiction fait même disparaître le dispositif théâtral et donc les spectateurs. Les cinéastes (y compris les réalisateurs des émissions musicales à la télévision), comprennent bien que le feedback renvoyé par le public aux artistes est un moment essentiel du rock, et que les corps sont en mouvement sur la scène et dans la salle. Plus généralement, les cinéastes saisissent que le rock n'est pas qu'une histoire d'artistes, mais aussi quelque chose qui concerne beaucoup d'autres dimensions. C'est vrai pour tous les arts, mais dans les films rock c'est très présent.
- Toutefois, lorsqu'ils filment le public, la misogynie des cinéastes est également très patente, notamment dans les films des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt. Les adolescentes sont “privilégiées”, montrées en train de hurler, de pleurer et présentées comme des groupies potentielles (c'est-à-dire prêtes à coucher avec leurs idoles), dans les concerts. On cantonne les femmes aux corps et aux émotions et on oublie que - pour ne prendre que l'exemple des Beatles - le public du rock est au moins autant masculin que féminin ; ainsi la caméra occulte souvent toute une partie de l'audience, et construit une représentation problématique des femmes.
Pour conclure ce développement sur le “live”, le studio, qui est l'autre grande caractéristique du rock, n’est pas non plus très présent dans les films. Après tout, inventer le rock c'est passer un temps considérable à l'enregistrer. C'est vrai qu'il y a le film de Godard,
One + One / Sympathy for the Devil (1969), où l'on voit et entend les Stones composer en studio, ou encore
Phantom of the paradise de Brian de Palma (1973), qui raconte comment la fabrication et l'enregistrement de la musique coïncident dans le rock. Mais, même si les scènes de studio sont présentes dans des films rock, la scène et les relations interpersonnelles attirent plus les caméras que les studios. À l'identique, les fans sont plus filmés dans les concerts que dans leurs chambres en train d'écouter au casque de la musique. Parfois, un espace rappelle pourtant l'autre, comme lorsque Joe Cocker mime la guitare à
Woodstock (pendant qu'il chante la chanson “With a little help from my friends"), nous rappelant que les amateurs (trices) de rock s'initient à la guitare dans leur chambre devant une glace et avec des disques.
Pour vous, un point important sur les rapports entre rock et cinéma, ce n’est pas seulement le cinéma qui filme le rock, ou le rock qui influence le cinéma, ce n’est pas seulement la question des œuvres, c’est la question de la fabrication des œuvres. ..Dans quel autre art que le cinéma retrouve t-on des producteurs, des gens qui sont tour-à-tour des financiers, des directeurs artistiques, des entrepreneurs créatifs ? Et dans quels arts, le processus même de fabrication de l’oeuvre consiste t-il à recourir aux machines et à l'électricité, à collaborer avec des ingénieurs dans un studio, à choisir les meilleures “prises”, à les monter et les mixer pour,
in fine, mettre le tout sur des supports enregistrés ? Les deux endroits où il y a ça, ce sont le rock et le cinéma. Le modèle de fonctionnement du rock - les outils techniques, le mode d’organisation du travail, la coopération entre divers types de métiers - s'inspire de celui du cinéma. On parle des studios d’Hollywood et des studios de musique et ce n'est évidemment pas pour rien. On pourrait évidemment m'objecter que toutes les musiques recourent à l'enregistrement et que la spécificité du rock n'est pas patente. À une telle objection, je répondrais que la caractéristique du rock (pensons aux Beatles là encore), est d'avoir fait du studio un lieu de création et non pas seulement de reproduction, où l'on vient enregistrer des partitions répétées au préalable (le classique), ou des impros que l'on joue dans des conditions aussi proches que possible de celles d'une performance (le jazz). Ce point est d'autant plus important aujourd’hui que ce processus technique n'est plus réservé - comme c'était le cas à l'époque des Beatles - aux professionnels et à la seule industrie musicale. Comme nous le rappelle le développement du hip-hop et de la techno, dans un home studio tout le monde peut désormais dé-composer la musique en un processus où interviennent : accumulations (et comparaison) des prises, sampling, montages, mixages, dialogue avec d'autres et fixation finale sur un support.
En termes d’innovations techniques, pensez-vous qu’il y ait un conservatisme technique du cinéma par rapport à la musique, au rock, qui serait, lui, en avance ? Il faudrait d’abord définir à partir de quels éléments et de quelles modalités on dit que quelque chose est « en avance » et « en retard ». Si l'on s'en tient au cinéma et que l'on compare l’inventivité technique et narrative du cinéma muet avec celle du cinéma parlant, beaucoup d’historiens du cinéma considèrent qu’il y a une régression, une sorte de standardisation, de normalisation. À l'inverse, on peut dire que le jeu des “acteurs parlants” s'est émancipé du théâtre, qu'il est devenu plus “moderne”. Tout cela pour dire justement que l'idée de modernité (donc de progression, d'avance), est devenue très problématique.
Donc, je ne dirais pas que la musique est en avance, mais plutôt que l'on pourrait s'intéresser à la façon dont la musique populaire exerce une influence sur la fabrication (les fabrications ?) du cinéma. Par exemple, depuis une vingtaine d’années, il y a de plus en plus de “monteurs musique” dans les productions cinématographiques, ce qui n’existait pas avant. Auparavant, les spécialistes du son au cinéma étaient les compositeurs (en amont du montage), les preneurs du son (pendant le tournage), et les bruiteurs et les mixeurs (au finish). On peut penser que l'essor du montage musique au cinéma peut être relié à la culture sonique, assimilée par les cinéastes et les techniciens qui ont passé leur adolescence à écouter au casque des centaines de disques de rock dans leurs chambres. De même, on peut aussi imaginer qu'à l'époque du home studio et de my space, on dispose de plus de souplesse pour innover et inventer des façons de faire qui seront exportées à l'image. Mais dans ce cas-là, répondre à votre question consisterait moins à savoir si la musique est en avance qu'à analyser les façons dont les innovations qui émergent du monde amateur (je pense en particulier au web), sont intégrées par le(s) monde(s) professionnel(s) du cinéma et de la musique.
Le film de rock véhicule traditionnellement des idées de jeunesse, de rébellion, des postures iconoclastes. Qu’en est-il actuellement, et quelle évolution pour le film rock ? On ne s’en sortira pas non plus si l’on dit, qu’avant, le film de rock était iconoclaste alors que maintenant il est plus commercial ou réconcilié avec le “réel". Si l’on reprend
A Hard Day’s Night, on trouvera effectivement ce côté iconoclaste. Le conflit des générations est sans arrêt mis en scène, les Beatles passent leur temps à se moquer des vieux (et d'eux-mêmes...), des gens du business ou de leur manager. Il y a aussi dans le film un faux grand-père de Paul McCartney, un irlandais républicain, qui insulte la royauté anglaise et les policiers et qui donne au film une tonalité un peu irrévérencieuse par rapport à la royauté. Dans la forme y compris, très proche de la nouvelle vague française, le film innove et rompt avec la façon de mettre en scène les crooners, ou Presley à Hollywood.
Mais, de nos jours,
24 Hour Party People de Michael Winterbottom, un film sur la scène new wave de Manchester à la fin des années 1970, n'est pas moins iconoclaste. Comme Richard Lester, Winterbottom agence de façon très originale les personnages réels et la fiction, les scènes de studio et de concerts, il montre les tournées sans concession à la mythologie rock, et dresse un portrait des artistes souvent sans complaisance. De plus, sa caméra a une grande intelligence des structures musicales, de la pulsation. Tout cela pour dire que l'on n’arrivera pas plus à trouver un âge d'or qu'à constater un renouveau ; il y a peut-être maintenant plus de 3000 films de rock et c'est très difficile de les ramener à des thématiques (la révolte, le refus des adultes), qui datent de l'époque où le rock était presque exclusivement une affaire de jeunes. Un sociologue qui s’appelle Fabien Hein dit que le rock n’existe pas. Je dirais qu'en un certain sens, il a raison. On ne peut pas schématiser “le rock", sous peine de le réduire. Il faut le comprendre, l'aborder dans sa diversité, comme une galaxie de styles qui compte des généalogies, des ancêtres, des révoltes, des alternatives : un monde en mouvement.
Le rock, comme musique, bande-son ou état d’esprit de ces nombreux films, était le symbole d’un clivage générationnel fort. Or, récupéré par la jeune génération aujourd’hui, le rock est-il toujours rébellion ? À cette question je réponds que la rébellion ne se limite pas une relation entre le “rock” et le monde, ou les “jeunes" et les “vieux", elle s'exprime aussi à l’intérieur du domaine rock. Une nouvelle génération veut toujours réinventer le rock, soit en le faisant progressif parce qu’il est trop brutal, soit en faisant de nouveau du rock’n’roll parce qu’il est trop progressif, soit en le faisant synthétique parce qu’on ne veut pas faire trop de technique instrumentale… Il y a une réinvention permanente des techniques et des styles, des façons d'être. N’importe quelle activité humaine – le rock y compris – consiste à contester ce qui existe, ou une partie de ce qui existe, et à trouver d'autres solutions collectives. Il y a toujours des gens qui inventent en dehors des circuits, qui se révoltent contre ce qui existe, qui redécouvrent des disques ignorés par les autres et s'appuient sur ces répertoires pour recomposer un nouveau monde (songeons aux DJ inventant le hip-hop avec des disques vinyles anciens). Le fait de disposer facilement de cinquante ans de répertoire musical enregistré (notamment via le web) rend les ”révoltes” et les ré-inventions plus dialectiques qu'autrefois. Des jeunes passionné-e-s peuvent avoir le déclic avec les Doors, la musique de leurs... parents ! Nombre de playlists échangées sur le net ou entre ami-e-s comprennent un Daft Punk, un Manu Chao, la chanson française du moment, un Madonna, un peu de techno, parfois un standard de jazz…
De plus, ces ré-inventions ne concernent pas seulement des styles musicaux, mais aussi l’environnement spatial et les outils : les hip-hoppeurs n’ont pas besoin de scènes de rock exactement comme les rockeurs et les raves de techno se font souvent en pleine campagne, les Dj mixent avec des platines plutôt que de jouer de la guitare électrique, etc... En bref, chaque courant musical a ses propres controverses et ses débats, ce qui
in fine signifie que même une génération se divise, se rebelle contre d'autres de ses contemporains. Il y a donc bien des rébellions, mais il faut savoir ouvrir l'objectif et ne pas croire que le fait de ne pas refaire comme ceux d'avant signifie que l'on a baissé pavillon.
Que pensez-vous de l'esthétique spécifique du clip de rock ? Le clip n'est-il pas le genre par excellence pour promouvoir cette musique ? Ce sont (peut-être) les Beatles qui ont été les pionniers dans ce domaine avec
Rain (1966), clip d'un single réalisé pour suppléer le fait qu’ils ne faisaient plus de concert (je crois que ce point est narré dans le DVD
Anthology). Mais évidemment, le clip est lié à l’essor de la télévision et à la montée de la chaîne MTV au début des années 1980. Au passage, on notera qu'un des promoteurs de ce format n'est autre que Michael Nesmith (un des membres des Monkees), qui a fondé au milieu des années soixante-dix la société
Pacific Arts Corporation.
La particularité du clip c’est son format court, qui permet une grande liberté formelle. On croit souvent que les contraintes restreignent les artistes et les techniciens, mais l'inverse est souvent également vrai. Il suffit de regarder les clips des années 80 - par exemple ceux du groupe
XTC - pour constater combien ce format a aussi été un laboratoire de création visuelle et d'humour. Interface entre la musique et l'auditeur, le clip est riche de sens. Comme les pochettes de disques, il constitue une sorte de marque, que l'on associe non seulement avec les mots ou les notes d'une musique mais aussi avec des moments de notre propre existence, et même avec une époque. Actuellement, avec le développement du web (où l'image et le son s'entremêlent constamment), et encore plus avec les plate-formes type YouTube, un nouveau pallier me semble avoir été franchi. Désormais, ce sont les internautes eux-mêmes qui créent leurs propres clips en ajoutant leur propre montage d’images sur une musique qu’ils aiment, devenant les cinéastes de leurs émotions. Il suffit de regarder les commentaires que font les autres fans d'un même groupe dans Youtube pour saisir combien cette mise en forme peut être partagée par d'autres.
Pour finir sur l’esthétisme, le rock au cinéma est aussi, pour vous, un certain vocabulaire du corps.
Le corps en mouvement, celui des musiciens et des musiciennes, celui du public des concerts, des raves ou des battles hip hop, celui des amateurs qui dansent dans leur chambre au son des disques est une composante essentielle du rock et de la culture populaire. Au cinéma, un des exemples paradigmatiques de cette importance du corps est
Saturday Night Fever (de John Badham - 1977), un film qui raconte comment des amateurs de danse se réalisent, s'expriment, voire se confrontent en musique avec leur corps. C'est aussi cette réinvention perpétuelle de la soma par la culture populaire que le cinéma - l'art de filmer des corps - nous permet d'entendre et de contempler.
Propos recueillis par Marie Corberand et Olivia Dallemagne Pistes de lectures :
Eduardo Guillot, "Rock et ciné" (Traduit de l’espagnol par Martine Monleau) - Éditions La Mascara France Paris 2000
Alain Lacombe, "L'écran du rock, 30 ans de cinéma et de rock music" Éditions Pierre l'Herminier Paris 1985
François Ribac (sous la direction de) “Rock et cinéma“ numéro hors-série de Volume ! Éditions Mélanie Séteun Clermont Ferrand Juin 2004

 Je viens de participer à un ouvrage collectif et prospectif consacré au devenir des artistes. Le livre s'appelle Artistes 2020, est édité par l'Irma (Information et Ressources des Musiques Actuelles) et résulte d'une collaboration entre cette dernière et l'Adami (société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes).
Je viens de participer à un ouvrage collectif et prospectif consacré au devenir des artistes. Le livre s'appelle Artistes 2020, est édité par l'Irma (Information et Ressources des Musiques Actuelles) et résulte d'une collaboration entre cette dernière et l'Adami (société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes).